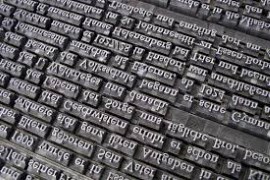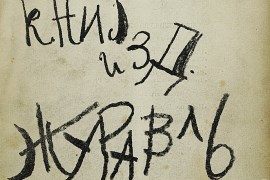Sciences morales, sciences sociales, sciences politiques et le débat sur la "crise fin de siècle" en Europe
pp. 17-37
Résumé
Les Français, intellectuels ou non, aiment à se comparer. Que ce soit dans le domaine intellectuel ou politique, deux nations les ont particulièrement inspirés : jusqu’en 1870, surtout l’Angleterre, depuis 1870, surtout l’Allemagne. Jusqu’à la fin du siècle, ces comparaisons avec les deux principales voisines restent fondées sur les anciens outils intellectuels fournis par les sciences morales et politiques. Avec l’apparition de nouvelles disciplines ou sciences en formation, les controverses et la lutte pour la légitimité entre elles traduisent à la fois des divergences de point de vue théorique mais aussi des antagonismes entre systèmes universitaires nationaux. Au total l’analyse de la crise fin de siècle est profondément influencée implicitement par les lieux communs diffusés par les journaux. En sens inverse, les précautions épistémologiques n’empêchent pas ces diverses interprétations d’être prises au piège des cadres a priori proposés dans le débat par les disciplines traditionnelles : l’essentialisme national, l’approche culturaliste statique, l’absence de distinction des échelles d’analyse, les corrélations globales a priori, voire les préjugés politiques implicites. Toutes ces maladies infantiles des sciences sociales n’ont rien d’étonnant étant donné la date récente d’apparition de ces sciences à l’époque considérée et la confusion entre vraies et fausses sciences.
Détails de la publication
Publié dans:
Bienenstock Myriam (2007) Néokantisme et sciences morales. Revue germanique internationale 6.
Pages: 17-37
DOI: 10.4000/rgi.251
Citation complète:
Charle Christophe, 2007, Sciences morales, sciences sociales, sciences politiques et le débat sur la "crise fin de siècle" en Europe. Revue germanique internationale 6, Néokantisme et sciences morales, 17-37. https://doi.org/10.4000/rgi.251.